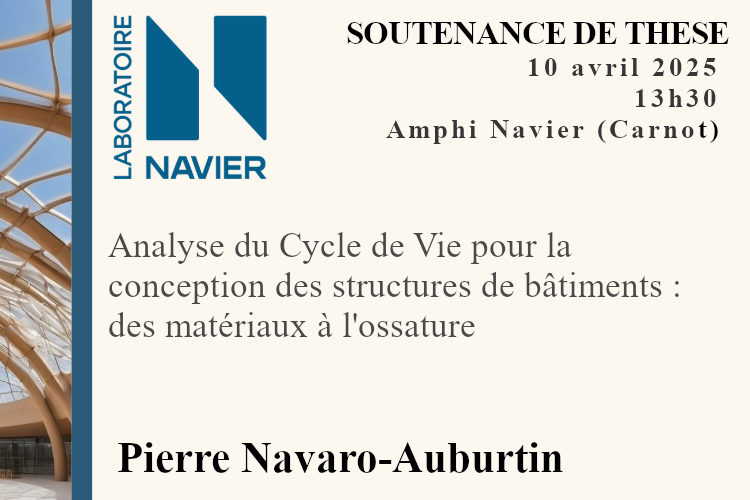
Soutenance de thèse – Pierre Navaro-Auburtin
- Post by: sebastien.gervillers
- 3 avril 2025
- No Comment
Pierre Navaro-Auburtin, doctorant au sein de l’équipe Matériaux et Structures Architecturées du laboratoire Navier soutiendra sa thèse « Analyse du Cycle de Vie pour la conception des structures de bâtiments : des matériaux à l’ossature » le jeudi 10 avril à 13h30 dans l’amphithéâtre Navier (Carnot).
Composition du jury :
- Cécile BULLE – Professeure, Université du Québec Montréal (Rapporteuse)
- Corentin FIVET – Professeur, EPFL Lausanne (Rapporteur)
- Catherine DE WOLF – Professeure assistante, ETH Zürich (Examinatrice)
- Nicolas PERRY – Professeur, ENSAM Bordeaux (Examinateur)
- Olivier Baverel –Professeur, École Nationale des Ponts et Chaussées (Directeur de thèse)
-
Myriam SAADE – Chargée de recherche, CNRS Ingénierie Paris (Co-encadrante de thèse)
-
Mathilde LOUËRAT – Cheffe de projet, CSTB Grenoble (Co-encadrante de thèse)
- Manuel Manthey – Ingénieur, CSTB (Co-encadrant de thèse)
- Frédéric DUBOIS – Ingénieur de recherche, LMGC Montpellier (Invité)
- Raphaël MENARD – Ingénieur-Architecte, AREP (Invité)
- Jean-Luc MARTIN – Ingénieur, AREP (Invité)
La soutenance pourra également être suivie en ligne
Résumé
Le secteur de la construction fait face à des crises multiples : changement climatique, dommages à la qualité des écosystèmes, enjeux de santé humaine et usage intensif des ressources. Dans ce contexte, cette thèse propose de quantifier les impacts environnementaux des structures de bâtiment et d’identifier des leviers pour réduire ces impacts. Afin de répondre à ces questions, ce manuscrit propose de coupler deux approches : la conception des structures et l’analyse en cycle de vie.
Cette méthode est développée sur plusieurs échelles. Tout d’abord à l’échelle du matériau. Une synthèse des travaux de la littérature est réalisée servant de fondation pour la suite du manuscrit. L’idée est d’évaluer l’impact de chaque matériau de structure sur différents indicateurs environnementaux ainsi que d’analyser certaines technologies pour réduire ces impacts.
L’approche est ensuite développée à l’échelle des éléments de structures tels que les poutres, poteaux et planchers. Ce sont les briques élémentaires constituant le vocabulaire structurel et permettant de développer des systèmes constructifs. Chaque élément peut se retrouver dans une variété de configuration géométrique (portée, hauteur, forme) et de chargement. Cela va influencer la quantité et le type de matériau mis en œuvre et donc les impacts environnementaux. Le but de cette partie est d’évaluer cette influence quantitativement. Elle permettra également d’explorer de nouveaux systèmes constructifs tels que les systèmes en pierre montrant ainsi la pertinence de ce type de structure.
L’étude porte ensuite sur des systèmes constructifs de bâtiment. Des structures de bâtiment classiques sont composées en utilisant les éléments structurels et matériaux précédemment décrits. Cette échelle permet de rendre compte de l’influence de la géométrie globale du bâtiment ainsi que des interactions entre les différents éléments structurels. Les études à plus petite échelle permettent alors de comprendre l’origine et les conséquences des choix de conception sur les impacts environnementaux. Un bâtiment n’étant pas seulement une ossature, l’influence de ces choix sur d’autres parties du bâtiment tel que l’énergétique est évalué.
Enfin, une évaluation des impacts futurs des structures est réalisée. En effet, l’arrivée des réglementations environnementales pousse les industriels du secteur à trouver des moyens pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à produire des feuilles de route de décarbonation. En repartant de ces hypothèses et de scénarios prospectifs, l’impact environnemental futur des structures est estimé. Cela permet d’une part d’orienter une stratégie quant aux matériaux à développer pour le secteur, mais également d’évaluer les éventuelles conséquences de la réduction d’impact du changement climatique sur d’autres impacts.


